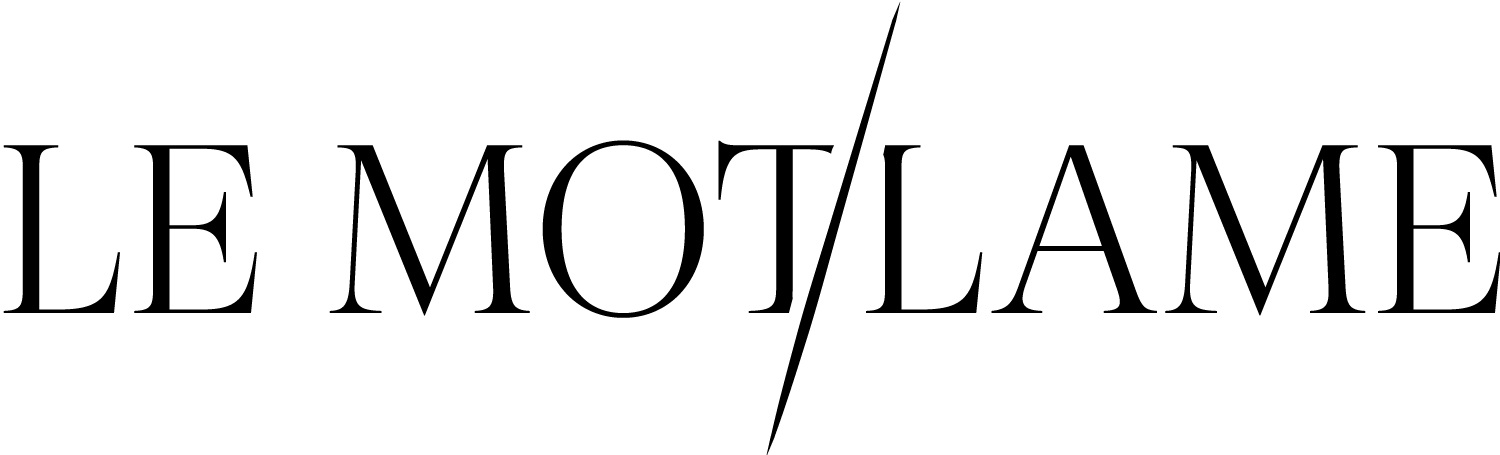Écrits de voyage signé Nathaniel M avec les photographies de Florence S.

Tu prends souvent la mer ?
La fenêtre s’ouvre et la brume fond sur les collines. Le lac Kivu s’étend à la sortie de notre chambre d’hôtel. Silence sur l’horizon. Des bananiers frémissent au loin. Nos regards se délient, nos yeux saisissent le monde comme si nous étions les premiers à l’observer. Nous sommes témoins de ce que fut le paradis sous l’œil de la création. Il est neuf heures et le soleil réchauffe nos peaux.

Tu prends souvent la mer ?
D’ici je vois les mille collines de sang sec, leurs flancs scarifiés, leurs chemins de cicatrices. Le relief des montagnes en crânes broyés. Sinueuses sont les rivières de sang, elles rigolent entre les cadavres, pourtant, l’azur n’a pas cessé d’être splendide. Où qu’on aille, j’aurais toujours un œil pour observer la beauté du monde et un œil pour me rappeler sa ténèbre, une oreille pour écouter les oiseaux, une autre pour entendre les chiens de l’Enfer. À la fois présent et sous un autre ciel.
Midi. Le vent brosse la cime des arbres à thé. Une odeur melliflue embaume l’atmosphère. Nos jambes descendent la colline pour gagner le large. Aujourd’hui, nous partons observer les pêcheurs. Aujourd’hui, nous prendrons la mer.
Face à la mer, le monde nous apparaît comme un pays sans souvenirs et sans regret : un pays où rien ne survit à la venue des nuits et où chaque jour, le lever du soleil, comme l’acte éblouissant d’une création spéciale, n’a aucun lien avec la veille ni avec le lendemain. La mer est une page blanche, je l’observe et me retourne vers toi. Nous nous taisons.

Nous nous sommes rencontrés il y a peu et on continue de s’observer du coin de l’œil. Tu prends souvent la mer et souvent nous l’avons pris ensemble. À la recherche d’une sensation.
Au bord du lac, des marins louent aux touristes des kayacs de sport. Nous embarquons sur une nacelle avec quatre avirons : deux pour toi, deux pour moi. J’en ai un qui a le manche cassé, il est rafistolé au scotch. Arrivé au milieu du lac, il se brise en deux. Nous peinons à ramer jusqu’à un restaurant à flanc de coteaux. Pour peu nous serions restés arrêtés au milieu du lac. C’est sur les coteaux que nous avons rencontré Bryan. Avec son moteur, il nous a ramené aux marins. Il les a embrouillés, le matériel était foireux, ça nous a mis en danger. On a payé pour une heure et navigué une trentaine de minutes. Il nous aide à récupérer la moitié des sous. Il a haussé le ton pour nous défendre, maintenant c’est notre héros. Il nous a embarqué sur son moteur pour faire le tour du lac. Assis à l’arrière, nous observons le soleil dorer ses prunelles quand il se retourne vers nous.
Nous étions partis à la recherche d’une sensation.
Sur le Kivu, j’écris « en mer », parce que d’ici on ne voit pas l’autre rive. Je pense à Hemingway, je pense à Conrad. Je pense à Lowry. Je pense à Melville. Je te regarde fermer les yeux et sentir le vent sur ton visage. En mer, nous retrouvons une sensation : d’abord on croit la prendre, on réalise ensuite que c’est la mer qui nous prend. Autour de nous c’est vague, à l’intérieur de nous ça tangue, partout ailleurs, c’est bleu. On s’oublie.
Je regarde au loin, la houle me fait valser. Je ferme les yeux et réalise n’être plus qu’une vague enfermée dans un corps.
Un instant durant, je n’ai plus ni peau ni visage, le vent pénètre mes pores et me soulève, le Soleil me réchauffe. Entre le ciel et moi disparaît la chair. C’est l’heure dorée. Nous approchons une île. Bryan dit qu’elle s’appelle l’île aux singes. On n’aperçoit cependant pas les babouins. Notre bateau frôle la côte et nous poussons des cris d’animaux, seulement rien ne bouge. Alors nous repartons vers le centre de l’horizon, riant et hurlant comme des sagouins.

Voici venus les pêcheurs. On les entend brailler. Les pêcheurs du lac Kivu entre le Rwanda et le Congo parlent une langue qu’ils ont inventée pour se comprendre. Certains chantent des chansons pour se donner le rythme. D’autres sifflent en cadence tout en poussant des cris. Leurs salaires sont d’environ neuf euros par mois. Ils vivent de la pêche et de l’argent des touristes qui s’embarquent sur leurs nacelles pour admirer le crépuscule à l’expédition du soir.
Ils passent, nos regards se croisent. Quand nous les prenons en photos, ils plaisantent et demandent de l’argent. Leurs corps sont musclés, sculptés par l’effort, bronzés par la réverbération, ils sont des statues d’éphèbes sur le lac, certains sont très jeunes, tous sont vêtus de short, leurs torses sont nus. Quand ils rament, leurs dos se jettent en avant, bien droit, ils abattent leurs avirons sur le méplat des vagues avec vigueur. Ils le font tous en rythme, avec leurs muscles luisant au soleil, répétant ces chants d’un temps sans mémoire.
La nuit s’avance et nous regagnons la rive. Bryan propose de dîner dans son village, nous hésitons à le suivre. Arrivés sur place c’est la nuit noire et précaire des quartiers de pêcheurs, les cases ne sont pas éclairées, il faut regarder au sol pour ne pas trébucher sur un fil électrique ou un moteur dépecé. Finalement, nous arrivons chez Bryan, commandons des bières en bouteille. Il nous met immédiatement à l’aise et parle de lui. Il fait de la peinture et entraîne des enfants à la course à pied. Quand nous arrivons chez lui, une quinzaine de gamins pieds nus attendent. Il les a envoyé courir vingt kilomètres, ils sont essoufflés, mais vaillants. Bryan les félicite et les libère. Ils partent sans prêter attention à nous.
En plus du bateau, il fait beaucoup de vélo, nage et participe à des triathlons. Dans son garage, il nous montre les vélos qu’il garde pour entraîner les équipes de jeunes, certains sont en réparation. Dans sa chambre, il nous montre ses peintures à l’huile, des vues sur le lac moiré de couleurs chaudes. Tu les apprécies. À sa table de chevet, je remarque un portrait de sa mère, elle est métisse et lui carteron.
Nous mangeons de la semoule de maïs avec de très petits poissons en sauce. Buvons et fumons. Bryan nous parle de ses projets, il n’est pas plus âgé que nous. Il trouve des solutions pour s’en sortir et économise pour rembourser son bateau. Il nous parle des courses à vélos, nous montre des photos de lui en compétition. Il a toujours le sourire et dégage une fraîcheur certaine. Plus tard, il nous raccompagne, car c’est déjà l’heure du couvre-feu.

Sur le chemin du retour, dans la nuit, nous levons les yeux, sans l’éclairage artificiel, les étoiles semblent nous tomber dessus très lentement. Nous regagnons l’hôtel en titubant, ivres de quelque chose, éclairant la route avec le flash de nos téléphones portables.
Ce jour-là, j’ai observé le monde et il n’était ni beau ni couvert de nuit, il était simple, il était immuable. Aujourd’hui, je regarde les photos que tu as prises et te remercie de l’autre côté de la rive.
Texte par Nathaniel et photographies par Florence S.